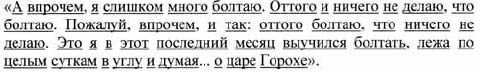
ANDRÉ LOISELLE
Generally, film adaptations of drama do not follow the principles of translation. There are too many differences between the original and the film version for the term “translation” to be applicable. However, there are a few cases where it can be said that a film actually translates a play. This article examines a number of adaptations of Canadian plays, in the light of various translation theories as well as narratological approaches, to draw a conceptual line between adaptation and translation. As is demonstrated, while Lilies, Les muses orphelines and Il était une fois dans l’Est cannot be read as translations of plays by Michel Marc Bouchard and Michel Tremblay, Tectonic Plates and Gapi can productively be studied as translations of original works by Théâtre Repère and Antonine Maillet. In the process, the author hopes to establish the basic charateristics of filmic translation.
Introduction: la problématique de la traduction
La problématique examinée dans cet article est la suivante: peuton parler de «traduction» pour décrire le processus d’adaptation cinématographique d’une pièce de théâtre? En étudiant certains films basés sur des pièces canadiennes, je tenterai de démontrer que, même si dans la majorité des cas le concept de «traduction» semble inapplicable, il y a certaines oeuvres cinématographiques qui sont de véritables traductions de textes dramatiques. Les exemples étudiés ci-dessous ont été choisis non seulement parce qu’ils sont sans doute connus des lecteurs mais aussi, et surtout, parce qu’ils offrent un éventail d’adaptations variées, ce qui nous permettra de bien évaluer la pertinence de l’approche traductologique pour analyser les procédés adaptatifs empruntés par les cinéastes. Comme on le verra, Lilies (1996) de John Greyson et Les Muses orphelines (2000) de Robert Favreau sont des adaptations intéressantes des pièces de Michel Marc Bouchard, mais n’en sont pas des «traductions.» Il était une fois dans l’Est (1973) d’André Brassard n’est pas, non plus, une traduction des pièces de Michel Tremblay mais plutôt une «narration» de la dramaturgie de l’auteur. Avec Tectonic Plates (1994) de Peter Mettler, on s’approche déjà plus d’une traduction du spectacle de Robert Lepage et du Théâtre Repère. Mais c’est Gapi (1981) de Paul Blouin qui représente le mieux ce qu’on pourrait considérer comme une traduction fidèle du drame d’Antonine Maillet.
Généralement, le concept d’adaptation cinématographique ne s’apparente guère aux principes de la traduction, du moins si l’on adopte une définition étroite de cette pratique comme «transcodage en langue d’arrivée des données du message contenu dans le texte de la langue de départ», pour citer Jean-Claude Gémar (12). Les théories contemporaines de l’adaptation parlent moins de transcodage que de «lecture hypertextuelle qui «amplifie, concrétise et actualise» l’hypotexte, ou texte antérieur (Stam 66).1 Selon Robert Stam, entre autres, l’adaptation est moins une traduction qu’un échange dialogique intertextuel entre l’original et la version, échange qui reconnaît et encourage la multiplicité des interprétations que tout texte, original ou version, peut engendrer (Stam 62-64). On trouve un exemple classique de cette théorie de l’adaptation dans le livre de Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, De la littérature au cinéma. Pour Ropars-Wuilleumier, une adaptation comme celle que Georges Franju a fait de Thomas l’imposteur de Cocteau en 1965 «instaure finalement un dialogue posthume entre Cocteau et Franju, chacune des oeuvres prenant place dans les intervalles de l’autre» (87).
Il est vrai que dans plusieurs adaptations cinématographiques d’oeuvres dramatiques le passage de la scène à l’écran ne se limite pas à un processus de «transcodage.» Pensons au film de Robert Favreau, Les Muses orphelines, basé sur la pièce de Michel Marc Bouchard. Cette adaptation ne traduit pas le drame original, car le cinéaste ne se restreint pas à remplacer les codes théâtraux par des équivalents cinématographiques. Par «codes théâtraux,» j’entends ici ce que Patrice Pavis (48-49) et Erika Fischer-Lichte (136-39) qualifient de «codes spécifiques» du théâtre, ou ce que Jean Alter (97) appelle les «codes iconiques» qui composent le système sémiotique primaire du théâtre, c’est-à-dire, ces éléments de la performance des acteurs, du décor, de l’éclairage etc. qui évoquent l’espace fictif du drame sans pourtant le reconstituer littéralement sur scène (Alter 98). Par exemple, dans la pièce de Bouchard, la maison des Tanguay, où se déroule l’action, est décrite par le dramaturge en termes minimalistes: «Une table à manger. Des chaises. Un orgue électrique» (Bouchard 12). La mise en scène d’André Brassard pour la première production de la pièce en septembre 1988 reposait aussi sur un minimalisme évocateur.2 Un «transcodage» cinématographique de cet environnement aurait pu être accompli soit en maintenant le minimalisme de l’original, soit, de façon plus typique, en situant l’action dans une cuisine concrète, car l’équivalent filmique conventionnel d’un décor théâtral minimaliste qui évoque un lieu véritable est en général une représentation relativement réaliste de ce lieu.3 Mais, dans ces deux cas, un transcodage pur et simple aurait respecté les unités d’espace et de temps auxquels la pièce adhère strictement. Cependant, le cinéaste ne se limite pas à un tel transcodage. Il opère une transformation radicale du matériau original, multipliant les lieux, changeant l’époque de l’action (les années soixante de la pièce deviennent le présent), ajoutant des personnages,métamorphosant le père soldat, mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, en pompier qui a donné sa vie pour combattre un feu de forêt légendaire. En fait, comme Favreau me l’a confié, il s’est constamment battu contre le théâtre pour en éliminer les moindres traces (Loiselle 104). L’adaptation, dans ce cas, est loin de s’en tenir à la traduction.
Si on voulait insister pour dire que le film de Favreau est en effet une traduction de la pièce, on pourrait essayer de donner une définition plus large du terme pour signifier non seulement la correspondance des codes mais aussi l’équivalence des effets, ce qui rejoint le concept d’équivalence dynamique d’Eugene Nida. Comme l’écrit Edmond Cary, «la qualité d’une traduction est toujours fonction de la fin poursuivie plutôt que des critères abstraits tirés d’une définition a priori. En outre, dès qu’on parle de fin, on est tenu de faire entrer en ligne de compte le public pour lequel travaille le traducteur» (Cary, cité dans Larose 78). Une telle définition de la traduction propose que sa valeur «est fonction de la façon dont le lecteur moyen sera susceptible de comprendre correctement la traduction qui lui est destinée» (Larose 79). Ceci implique que certains changements importants peuvent être nécessaires lors de la traduction pour s’assurer que le lecteur comprendra le sens du texte et non seulement les mots. Selon cette définition on pourrait prétendre que l’adaptation de Favreau est en partie une «traduction performative» (Larose 78) qui vise à recréer le même effet que l’original sans trop se soucier de l’exactitude du transcodage. Transformer le père en pompier valeureux, par exemple, pourrait être interprété comme une «équivalence dynamique » (ibid.) qui modernise l’image du père courageux pour un public qui ne reconnaîtrait peut-être plus l’héroïsme des soldats. Cependant, il s’agit ici d’un faux argument car, pour le «traducteur » Favreau, ce besoin de moderniser l’image du père était moins motivé par des questions de réception que de production.
Favreau a modernisé la fonction du père, ainsi que la plus grande partie du texte de Bouchard, non pour mieux rejoindre son public qui est, à vrai dire, sensiblement le même que celui de la pièce créée à peine une décennie plus tôt, mais bien pour éviter les complications reliées à la production d’un film d’époque (Loiselle 101). Rien dans le processus d’adaptation n’obligeait Favreau à soumettre le texte à cette mécanique d’actualisation. Dans son livre Théories contemporaines de la traduction, Robert Larose parle du principe de nécessité dans les transformations que le traducteur doit apporter au texte original. «L’arrière-plan socio-culturel» du texte traduit (ou texte d’arrivée) peut exiger certains changements pour rendre le texte original (ou texte de départ) compréhensible. Mais, selon l’auteur, pour qu’il s’agisse d’une traduction réussie plutôt que d’un «échec de traduction,» il faut que «les différences entre le TD [texte de départ] et le TA [texte d’arrivée] résultent … d’une nécessité, plutôt que d’un choix» (Larose 229). On peut considérer le film comme une bonne ou une mauvaise adaptation. Mais il est impossible d’affirmer que Les Muses orphelines de Favreau constitue une traduction, même performative, du texte de Bouchard car les choix du cinéaste n’étaient pas dictés par une tentative de maintenir un haut «degré d’adéquation» (Larose 289) entre la traduction et l’original, mais bien par des forces tout à fait extérieures au sens du texte – les contraintes de production du film historique.
«Degré d’adéquation» entre l’original et la version:
Lilies/Les Feluettes
Il en va de même pour l’adaptation cinématographique d’une autre pièce de Bouchard, Les Feluettes (1987), mais pour différentes raisons. Lorsque Bouchard a travaillé à la traduction/adaptation des Feluettes avec Linda Gaboriau et John Greyson, les adaptateurs ont choisi de respecter dans le film, Lilies, les deux époques (1952 et 1912) au cours desquelles les diverses actions du drame se déroulent.Greyson a même choisi de conserver l’élément de travestisme de l’original – dans le film comme dans la pièce, tous les rôles, masculins et féminins, sont interprétés par des hommes. Cependant, Lilies, le film, n’est pas une traduction au même titre que Lilies, la pièce traduite en anglais, dans laquelle Gaboriau vise une certaine adéquation dans les répliques de chaque personnage. Quand on place les deux textes côte à côte, on voit (littéralement) la correspondance des répliques. Il y a évidemment des différences entre l’original et la traduction. Entre autres, la démarcation claire des niveaux de langue dans le texte de Bouchard (entre le dialecte des paysans de Roberval, le français canadien standard des gens éduqués et le français parisien des visiteurs en provenance de France) est grandement amoindrie dans la version anglaise, car l’anglais canadien est moins stratifié que le français (et même si l’anglais britannique pouvait signifier cette démarcation par l’accent, certaines différences entre le français parisien et le français canadien – telle l’utilisation plus commune du «tu» au Canada – restent difficiles à reproduire en anglais).
Malgré ces changements nécessaires, Gaboriau atteint un niveau très élevé d’adéquation entre les dialogues de départ et d’arrivée. Cette adéquation disparaît presque complètement dans le film de Greyson, où à peine 25 % des répliques originales ont été conservées (Rice-Baker 43). Qui plus est, la conclusion de la pièce a été profondément altérée dans le processus d’adaptation cinématographique, non par nécessité socio-culturelle mais bien parce que le cinéaste a tenu à changer le message du texte. Alors que dans la pièce les deux adolescents amoureux, Simon et Vallier, choisissent de mourir par les flammes plutôt que de vivre dans un milieu homophobe, dans le film, c’est un acte de vengeance de la part du tiers personnage, Bilodeau, qui cause la mort de Vallier. Dans les deux cas, Bilodeau sauve Simon du brasier mais y laisse périr Vallier.Cependant, dans la pièce, c’est Simon qui allume le feu par lequel s’opérera l’immolation au nom de l’amour impossible.Dans le film, au contraire, c’est Bilodeau qui, par jalousie, jette au sol la lampe qui provoquera l’incendie dans lequel Vallier sera brûlé vif. Les raisons pour lesquelles Greyson a exigé cette transformation frisent la rectitude politique : il ne voulait pas communiquer aux jeunes spectateurs gays le message que le suicide romantique peut représenter un geste de résistance contre l’homophobie (Belzil 51). Encore une fois, on ne peut parler de traduction ou de transcodage dans le cas de Lilies, parce que les changements effectués par le cinéaste ne s’expliquent pas par la nécessité. Lilies est peut-être une excellente adaptation mais ce n’est pas une traduction.
Traduction et médias
La question demeure donc: y a-t-il des cas où l’adaptation peut être légitimement assimilée aux principes de la traduction? Selon Larose, il semblerait que la réponse est tout simplement non, à cause de la «composante matérielle.» À ce sujet, il écrit:
La composante matérielle désigne l’adéquation de la forme de composition des textes en présence ou, si l’on préfère, de leur médium de communication: une telle adéquation serait absente dans des rapports du type traduction illustrée/traduction non illustrée, traduction reflétant la langue parlée/traduction ne reflétant pas la langue parlée.‘On ne doit pas faire d’un conte un roman, d’une épopée un sketch de cabaret, etc., écrit Tarnóczi, car ce n’est plus une traduction.’ (227)
En d’autres termes, pour Larose le concept de traduction ne s’applique qu’au transcodage intra-médiatique. Le roman In the Shadow of the Wind de Sheila Fischman est donc une traduction du roman d’Anne Hébert Les Fous de Bassan (1982), mais le film Les Fous de Bassan d’Yves Simoneau en est une adaptation car il s’agit ici d’une transformation inter-médiatique. Les théories de l’adaptation font une distinction semblable. Comme Thierry Groensteen l’affirme dans Transécriture : pour une théorie de l’adaptation, «on appelle ”adaptation” le processus de translation créant une oeuvre OE2 à partir d’une oeuvre OE1 préexistante, lorsque OE2 n’utilise pas, ou pas seulement, les mêmes matériaux de l’expression que OE1 […] L’adaptation est au sens strict, la réincarnation d’une oeuvre OE1 dans un média différent de celui qui lui servait originellement de support (273-75). Pour Groensteen, on parle d’adaptation si OE1 et OE2 utilisent des médias ou des «matériaux de l’expression» différents. Ce qui implique que si les médias (ou composantes matérielles) ne sont pas différents, on parle déjà moins d’adaptation que de traduction.
Alors que la distinction médiatique entre traduction et adaptation peut sembler très claire dans l’exemple du roman Les Fous de Bassan cité plus haut, les choses se compliquent si l’on parle de pièce de théâtre, car il y a une divergence importante entre l’adaptation d’un roman et la transposition filmique d’un texte écrit pour la scène. Même les adaptations de romans dites fidèles ne peuvent être réalisées sans une transformation complète du matériau littéraire abstrait (des mots imprimés sur une page) en percepts sonores et visuels. Dans son livre, Adaptations as Imitation: Films from Novels, James Griffith suggère que certains films peuvent offrir des équivalents exacts dans la transposition de passages littéraires. La narration en «voix hors-champ,» par exemple, peut recréer mot pour mot le texte d’un roman (Griffith 42). Le montage peut aussi reproduire à l’écran des métaphores linguistiques. Griffith donne l’exemple de l’expression «the herd of commuters,» qui pourrait s’exprimer par un plan montrant des voitures dans un embouteillage suivi d’un plan qui montre un troupeau de bétails (43). Mais dans les deux cas, bien que l’idée du texte soit communiquée fidèlement, les modes d’expression sont tout à fait différents. Il y a une différence fondamentale entre lire l’information et la voir ou l’entendre . La langue écrite est une abstraction pure, alors que le son et l’image sont, en général, des incarnations manifestes du monde concret. Si je ne lis pas l’anglais, l’expression «the herd of commuters» n’aura aucun sens pour moi, alors que le raccord entre l’embouteillage et le troupeau pourra toujours insinuer un certain rapport entre les deux éléments du montage.4
Les différences entre le média écrit qu’est le roman et le média visuel et sonore qu’est le cinéma exigent un processus d’adaptation. Comme l’explique George Bluestone dans son ouvrage Novels into Film ,
What happens, therefore,when the filmist undertakes the adaptation of a novel, given the inevitable mutation, is that he does not convert the novel at all. What he adapts is a kind of paraphrase of the novel – the novel viewed as raw material. He looks not to the organic novel, whose language is inseparable from its theme, but to the characters and incidents which have somehow detached themselves from language. (61-62)
Mais ne pourrait-on pas parler de traduction entre le média sonore et visuel qu’est le cinéma et le média sonore et visuel qu’est le théâtre? Sans prétendre comme Charles Eidsvik (233)5 qu’il n’y a pas de différences irréductibles entre le théâtre et le cinéma (233), ne pourrait-on pas émettre l’hypothèse que les très grandes similarités entre les systèmes sémiotiques des deux formes rendent possible un simple «transcodage» du langage théâtral au langage filmique? Je croirais que oui et qu’il y a des cas où le passage du théâtre au cinéma peut correspondre à un processus de traduction.
Traduction et monstration
Selon André Gaudreault, le théâtre et le cinéma partagent au moins un mode d’expression: la monstration profilmique. Dans son livre Du littéraire au filmique: système du récit, Gaudreault explique que le cinéma communique son contenu par une double opération: la monstration, qui utilise le plan continu, et la narration, qui juxtapose les plans par diverses techniques de montage. La monstration désigne le procédé par lequel une histoire est communiquée au spectateur par des personnages en action (Gaudreault 91). Au cinéma, il y a deux types de monstration: la monstration profilmique et la monstration filmographique. La première, pour Gaudreault, «équivaut au cinéma au travail du monstrateur scénique de l’activité théâtrale» (121). Le «profilmique» est tout ce qui existe devant la caméra et qu’elle peut enregistrer. Imaginons une performance des Belles-soeurs de Tremblay sur la scène d’un théâtre. Il s’agit ici, évidemment, de théâtre. Imaginons maintenant qu’on positionne une caméra quelque part dans la salle et qu’on enregistre la performance sans rien changer aux codes du théâtre ou même bouger la caméra pendant l’enregistrement. Dans le cas de cet enregistrement en plan-séquence statique, la monstration théâtrale (le jeu des acteurs, le décor, le son, l’éclairage, tout ce que la performance montre au spectateur) correspond exactement à la monstration profilmique. Ici, à vrai dire, on ne parle pas encore de transcodage ou de traduction car les codes du théâtre ne sont nullement altérés par la présence de la caméra qui enregistre discrètement tout ce qui se déroule devant elle sans faire appel aux codes cinématographiques du cadrage et du montage.
Mais on peut parler de traduction du théâtre au cinéma lorsqu’on ajoute à la monstration profilmique la monstration filmographique. À la base, la monstration filmographique repose sur la mobilité de la caméra. À l’opposé du spectateur de théâtre qui regarde la scène (en général) d’une position fixe, la caméra peut se déplacer, s’approcher de l’acteur et du décor, observer la scène en plongée ou en contre-plongée, etc. Ces différents cadrages sont des codes cinématographiques et non théâtraux. Selon les historiens du cinéma, comme Tom Gunning, c’est d’ailleurs vers 1900, au moment historique où la caméra s’est mise à se déplacer dans l’espace, que le cinéma s’est affranchi du théâtre (Gaudreault 122). C’est à ce moment que le cinéma a commencé à inventer ses propres codes pour traduire en langage cinématographique ce qu’il n’avait, auparavant, que calqué sur le théâtre. Par exemple, les diverses positions que la caméra peut adopter équivalent aux techniques que le théâtre emploie pour guider le regard du spectateur. Imaginons la scène des Belles-soeurs pendant laquelle Pierrette Guérin parle de sa vie, qu’elle a gâchée au coté de Johnny. Le code théâtral utilisé ici pour isoler Pierrette et faire d’elle le centre d’attraction de la pièce à ce moment précis de la représentation est décrit explicitement par Tremblay dans une brève didascalie: «Projecteur sur Pierrette Guérin» (60). L’utilisation du projecteur qui concentre l’attention du spectateur de théâtre sur Pierrette pourrait se traduire en monstration filmographique par un cadrage resserré sur la jeune femme. Il s’agit ici en effet d’un transcodage par lequel le code théâtral est remplacé par un code cinématographique différent mais équivalent. Ce qui était accompli par le langage théâtral (le projecteur) l’est maintenant par le gros plan cinématographique.Ce que le théâtre effectue en guidant par la lumière le regard du spectateur distant, le cinéma le traduit en approchant la caméra du sujet. C’est d’ailleurs ce qu’André Brassard fait dans son film Il était une fois dans l’Est (1973) pour traduire les divers monologues qu’il emprunte au théâtre de Tremblay.
Monstration et narration: Il était une fois dans l’Est
Mais si certains moments d’Il était une fois dans l’Est réalisent des transcodages cinématographiques, le film dans son ensemble n’est pas une traduction des Belles-soeurs ou de quelle qu’autre pièce de Tremblay, car le récit se déplace constamment d’une oeuvre à l’autre, amalgamant les personnages d’une demi-douzaine de textes de Tremblay. Passant instantanément de l’appartement de Germaine Lauzon aux bars gays de la Main, du passé d’Hosanna au futur de La Duchesse de Langeais, Il était une fois dans l’Est ne se limite pas à la monstration filmographique mais fait aussi appel à la narration filmographique. Ce mode narratif entre en jeu dès que le cinéma rompt avec la continuité spatiale et temporelle qui gouverne la monstration. «Elle aura beau avoir la possibilité de se dissocier de la monstration profilmique,» écrit Gaudreault,
s’autonomiser par rapport à elle et lui adjoindre une autre couche langagière, la monstration filmographique n’en demeure pas moins rivée, tout comme celle-ci et au même titre, au hic et nunc de l’énoncé. [...] Impossible pour [le monstrateur filmographique] de réaliser ce qui est l’enfance de l’art pour tout narrateur digne de ce nom: se déplacer instantanément (temps) d’un endroit (espace) à un autre. (123)
La monstration, qu’elle soit théâtrale, profilmique ou filmographique, est déterminée par la continuité de l’espace et du temps. Ce qui ne veut pas dire unité d’espace et de temps. On n’a qu’à penser à toutes ces pièces shakespeariennes qui ne respectent aucunement les trois unités. Mais la continuité de l’espace et du temps, elle, est conservée, en ce sens que toutes les actions que l’on observe dans King Lear, par exemple, qu’elles se déroulent au château du vieux roi ou sur la lande ravagée par l’orage, sont jouées sur la même scène maintenant. La mimèsis de la monstration implique que les événements auxquels le spectateur assiste sont des incarnations physiques de l’action, ce qui signifie que le monstrateur dépend de la réalité physique par laquelle il montre.La succession de scènes de King Lear peut couvrir un grand espace et une période de temps considérable, mais au moment de sa performance, chaque épisode montre ce qui se passe dans l’ici-et-maintenant de la réalité physique des acteurs et du décor. Il en va de même pour la monstration filmographique qui montre ce qui ce passe ici et maintenant. Par exemple, l’action de «l’arroseur arrosé» tournée il y a plus de 100 ans par les frères Lumière nous est toujours montrée au présent et non pas racontée par une instance narrative qui nous dit «il était une fois, un jardinier et un petit garçon espiègle…».
Au contraire de la monstration, la narration, comme on la retrouve dans le roman, est une abstraction qui jouit d’une distance face au matériau du récit. Le narrateur littéraire n’est pas incarné physiquement, il n’existe pas en tant que corps et décor. Habitant une sphère autre que la réalité physique, il a donc accès à tous les espaces et à tous les temps simultanément. Dès le début de la narration, tout s’est déjà déroulé (Gaudreault 30). Le narrateur peut donc aisément passer d’un lieu à un autre, d’une époque à une autre sans avoir à se soucier des contraintes physiques. Il en va de même du narrateur filmographique qui peut passer d’un lieu à un autre, sans devoir se limiter à l’évocation, qui est l’outil du monstrateur (ce dernier peut évoquer tout ailleurs mais ne peut échapper au ici). Selon Gaudreault,
Ce que [le monstrateur] me présente maintenant a beau s’être produit avant qu’il ne me le montre, sa monstration, en tant que procès, est une « narration » simultanée rigoureusement synchrone pour reprendre le terme de [Gérard] Genette. Seul le narrateur peut se permettre de nous amener, avec lui, sur son tapis volant à travers le temps […] C’est lui qui re-met, devant mes yeux, dans l’ordre qui lui sied, ces événements qui se sont déjà produits. (Gaudreault 111)
Ainsi donc, dès que la caméra de Brassard quitte la cuisine de Germaine Lauzon pour nous emmener avec elle au bar Chez Sandra ou dans l’appartement d’Hosanna ou dans l’avion qui ramène la Duchesse de Langeais du Mexique, la monstration filmique cesse de traduire les pièces de Tremblay et offre plutôt une narration de l’univers du dramaturge a posteriori. «L’image en tant que plan (en tant que suite ininterrompue de photogrammes), écrit Gaudreault, est perçue comme présent mais le montage permet l’interruption d’une instance narrative qui prend le spectateur «par la main» afin de lui faire éprouver différentes expériences temporelles» (111-12). Alors que la scène que le monstrateur montre signifie «voici ce qui se passe maintenant chez Germaine Lauzon,» dès qu’il y a un raccord avec un autre lieu, la narration nous dit: «vous venez d’assister à ce qui se passait chez Germaine Lauzon au même moment où autre chose se passait chez Hosanna.»6 Dès qu’il y a narration on s’éloigne de la traduction, car les codes de la monstration théâtrale ne sont plus transposés en codes de la monstration filmographique, mais plutôt paraphrasés, pour utiliser le terme de Bluestone, en codes narratifs.
De la monstration à la narration, de la traduction à l’adaptation: Tectonic Plates
On trouve un exemple intéressant de traduction cinématographique dans Tectonic Plates (1992) de Peter Mettler, qui transpose le spectacle de Robert Lepage et du Théâtre Repère. Le film, à vrai dire, présente à la fois des exemples de traduction, où la monstration filmique transcode la monstration théâtrale, et d’adaptation, où la narration filmographique se détache complètement de l’original théâtral. Certains passages du film sont tournés sur la scène même d’un théâtre. Ici, la caméra n’est parfois qu’un spectateur privilégié qui peut se promener parmi les acteurs et scruter les visages dans leurs moindres détails, offrant ainsi un équivalent cinématographique aux techniques théâtrales de jeu amplifié et de maquillage exagéré. Ailleurs, on a recours au narrateur de façon évidente quand, en une fraction de seconde, la caméra quitte le théâtre pour nous transporter à Venise ou en Écosse.
Il y a un moment en particulier où le passage de la monstration filmographique à la narration, et donc de la traduction à l’adaptation, s’effectue de façon très instructive. Cette scène nous montre tout d’abord un personnage,William, dans une «gondole à Venise.» Le film évoqueVenise en montrant William assis par terre sur scène, jouant à être dans une gondole avec un autre acteur qui, lui, se tient debout et joue le gondolier pendant qu’une projection arrière nous montre des images de la ville. La caméra traduit ici, par l’intermédiaire d’un plan général, les techniques d’évocation que le théâtre (surtout chez Lepage) utilise régulièrement. Puis, soudainement, un changement de plan nous amène à Venise. En un instant, la traduction filmographique de la production théâtrale se transforme en narration, en paraphrase, car soudainement le film ne se limite plus à traduire les codes de la scène, mais introduit un nouveau rapport à l’espace.On n’évoque plus Venise, on est à Venise. Si le théâtre de Lepage était réaliste et visait à recréer sur scène une image aussi fidèle que possible de Venise, la traduction cinématographique pourrait remplir sa tâche en utilisant les codes du réalisme cinématographique pour créer une image aussi fidèle que possible de la ville en question. Mais le théâtre de Lepage n’est pas réaliste. Il évoque. C’est pourquoi en passant de l’évocation à la représentation, le film de Mettler cesse d’être traduction car on ne parle plus d’équivalence entre les langages.
Ailleurs, cependant, Mettler accomplit rigoureusement sa fonction de traducteur, entre autres, dans la scène où Jennifer, interprétée par Lepage lui-même, rencontre un jeune homme dans un restaurant new-yorkais. Pendant tout l’échange entre les deux personnages le film ne cesse de traduire l’évocation du restaurant, ne transformant jamais le décor minimaliste en lieu réaliste. Le traducteur filmographique ne fait que transmettre la scène selon les codes cinématographiques appropriés. Il faut noter qu’il ne s’agit pas ici d’un simple enregistrement statique de l’événement profilmique, car les codes du cinéma, en particulier le champscontre- champs (shot-reverse-shot), sont utilisés pour guider l’attention du spectateur entre les deux interlocuteurs. Alors que, sur scène, les voix des acteurs et surtout leurs présences physiques suffisent à donner un rythme visuel au dialogue (le spectateur transférera son attention d’un acteur à l’autre selon l’échange), au cinéma les corps des personnages se fondent dans le décor et tendent à disparaître si on ne montre pas les visages qui nous parlent.7 Il faut donc créer un rythme en alternant les plans d’un personnage à l’autre. Le cinéma traduit donc le dialogue entre Jennifer et le jeune Américain non pas en nous situant dans un vrai restaurant, mais en n’apportant que des changements qui sont nécessaires, c’est-à-dire, l’alternance des plans, d’un individu à l’autre, selon le rythme du dialogue.
Pour Gaudreault, il ne s’agirait plus ici de monstration filmographique pure et simple mais bien de narration «à tendance monstrative,» (125) car tout raccord entre deux plans représente pour lui une interruption de la continuité de temps et d’espace inhérente à la monstration. Mais cette «narration à tendance monstrative» est selon moi la pratique qui se rapproche le plus des principes de la traduction, car cette narration transporte la traduction cinématographique au-delà du simple «théâtre filmé» – où le cinéma se limite à enregistrer l’événement profilmique – et sa tendance monstrative fait en sorte que le cinéma demeure aussi fidèle à l’original qu’une traduction devrait l’être.
«Narration à tendance monstrative» et traduction du théâtre au cinéma: Gapi
Un excellent exemple de traduction (ce qui ne veut pas nécessairement dire qu’il s’agit d’une excellente adaptation) est le film de Paul Blouin, Gapi, inspiré de la pièce d’Antonine Maillet, créée en 1976. Depuis la mort de sa femme, la Sagouine, Gapi vit seul «sur une dune de sable et de roches, devant un phare, en Acadie» (Maillet 23). Ses seuls compagnons sont les goélands auxquels il parle tout au long du premier acte. Le vieil ermite s’ennuie tout particulièrement de Sullivan, le marin globe-trotteur qu’il n’a pas vu depuis trois ans. C’est ce que Sullivan incarne qui manque le plus à Gapi: la liberté, le mouvement, le voyage. Mais, en même temps, Gapi apprécie sa propre vie sédentaire. Comme il l’exprime dans sa langue acadienne: «Trois ans qu’il est point revenu le navigueux. Trois ans sus l’eau à voguer d’une mer à l’autre, d’une terre à l’autre, d’une vie à l’autre. Une vie de chien … Ben des fois, je me demande si sa vie de chien vaut pas c’tell-là d’un pêcheux de coques pis de hareng. Pis c’telle-là d’un allumeux de fanal» (Maillet 51). Le coeur du drame de Gapi est simple: «Partir ou rester? Tel est le débat intérieur qui agite Gapi» écrit Zénon Chiasson au sujet de la première version de la pièce, intitulée Gapi et Sullivan (365).
Le dilemme se concrétise à la fin du premier acte quand Sullivan revient voir son ami Gapi. Au cours du deuxième acte, le marin parle de ses aventures en mer, alors que le gardien de phare insiste sur la valeur d’une vie solidement enracinée sur la terre ancestrale. Mais quand Sullivan décrit «les fesses de la belle Immaculata» (Maillet 74), une femme qu’il a rencontrée lors d’un voyage, le vieux Gapi se décide à partir: «je m’emblarque itou» (Maillet 76). Cependant, comme si le phare devenait jaloux, il s’éteint pour rappeler son devoir à Gapi. Le gardien réaffirme alors l’importance de sa vie sur les côtes de l’Acadie et invite Sullivan à rester avec lui sur la dune: «Laisse quitter ta goèlette, Sullivan. La dune est grande assez pour deux» (Maillet 46). Mais Sullivan ne peut abandonner la mer, pas plus que Gapi ne peut abandonner son phare. Le marin retourne au large et gardien de phare reprend son dialogue avec les goélands.
La traduction cinématographique que Blouin réalise du texte est presque littérale. Reproduisant à la lettre les indications scéniques de Maillet, le cinéaste situe l’action de son film «sur une dune de sable et de roches.» On pourrait argumenter qu’en ayant tourné le film sur une vraie dune (à l’Île-du-Prince-Édouard), Blouin trahit l’original. Mais en fait, l’environnement naturel dans lequel Gapi et Sullivan se déplacent dans le film représente une traduction tout à fait adéquate du décor théâtral, car les codes du réalisme scénographique sont tout simplement remplacés par les codes du réalisme cinématographique. Le réalisme du film est aussi fidèle au réalisme de la pièce de Maillet que le minimalisme de la monstration filmique dans Tectonic Plates l’est au spectacle original du Théâtre Repère.
De plus, Blouin ne se laisse jamais séduire par l’attrait du retour arrière. Alors qu’il aurait pu aisément donner dans la narration cinématographique pour illustrer les anecdotes de Sullivan, en nous transportant instantanément de la côte acadienne à un bar des mers du Sud pour nous montrer «la belle Immaculata [qui] vient s’assire sus [les] genoux du vieux marin,» (Maillet 76) Blouin s’en tient strictement à la «narration à tendance monstrative. » Ceci ne veut pas dire qu’il se limite à enregistrer le contenu de la pièce. Au contraire, Blouin effectue bel est bien un travail de traduction, car Gapi n’est certes pas que du théâtre filmé. En effet, le réalisateur utilise les codes du cinéma pour traduire la structure du dialogue. Comme je l’ai souligné plus haut, le théâtre peut s’en remettre presque exclusivement à la présence des acteurs pour donner vie au dialogue des personnages, mais le cinéma a une telle facilité à représenter l’environnement qu’il peut se passer complètement d’acteurs.8 Mais si on choisit de mettre l’accent sur le dialogue, on doit faire un effort technique considérable pour insuf- fler un certain rythme à la parole, car elle risque toujours de se perdre dans l’immensité de l’univers cinématographique. Par conséquent, tout au long du film, Blouin utilise une rhétorique cinématographique qui ponctue le monologue de Gapi – suivant souvent le rythme même des paragraphes du texte – ainsi que le dialogue avec Sullivan selon une structure visuelle qui incarne la dialectique du drame.
Chaque segment commence avec un plan général qui reproduit à peu près la perspective théâtrale, puis, à mesure que le monologue devient plus introspectif ou le dialogue plus intense, la caméra s’approche du sujet – plan moyen, gros plan – jusqu’à ce qu’il y ait un changement significatif de ton ou de thème dans les répliques, ce qui réintroduit le plan général pour souligner le début d’une nouvelle section du drame. Ce mouvement suivi qui part d’une perspective éloignée, progresse vers un cadrage serré, puis retourne à un point de vue distancié, reproduit visuellement les fluctuations discursives du personnage qui oscille constamment entre l’attrait efférent qu’exerce l’idée du voyage et la force centri- pète du sentiment d’appartenance à la dune. Cette technique est bien illustrée dans la scène qui correspond à la fin du premier acte, au cours de laquelle Gapi déplore l’absence prolongée de son ami et en vient à croire qu’il ne le reverra plus jamais.
Ce segment commence avec un plan général qui nous montre le vieil homme marchant sur la berge, la mer et le ciel occupant une partie importante du cadre. À mesure que Gapi en vient à accepter son état d’isolement, presque d’emprisonnement solitaire sur la dune, le cadrage se resserre jusqu’à ce qu’un gros plan ne montre plus que son visage et ses épaules. C’est à ce moment que Sullivan annonce son arrivée avec une litanie de sacres chaleureux : «Câlisse de tabarnacle de Gapi!» (Maillet 55).Du coup, la caméra s’éloigne, réintroduit la mer et le ciel et signale le début d’un segment où les nombreuses joies de la vie de marin sont énumérées pour le plus grand plaisir de l’ermite. De la même façon, les passages qui mettent l’accent sur les aventures de Sullivan utilisent majoritairement des plans éloignés alors que les moments où Gapi essaie de convaincre son ami de rester avec lui sur la dune comptent plus de gros plans.
Conclusion: adaptation verus traduction
L’utilisation de ces codes filmographiques permet un si haut degré d’adéquation entre le texte de départ et le texte d’arrivée qu’on peut certainement reconnaître dans le film de Blouin une traduction cinématographique fidèle de la pièce de Maillet. Le film n’est ni théâtre filmé, comme Paper Wheat (1979) d’Albert Kish ou Le Grand Film ordinaire (1970) de Roger Frappier, ni une adaptation libre, comme Love and Human Remains (1993) de Denys Arcand ou Bordertown Café (1993) de Norma Bailey. C’est bel et bien un exemple de transcodage. Mais le travail de traduction accompli par Blouin ne signifie pas nécessairement que son parti pris de fidélité soit supérieur à l’esprit plus créateur de Favreau, Greyson, Arcand ou Bailey. D’ailleurs, le film de Blouin n’a pas été particulièrement bien reçu.9 La question n’est pas de savoir ce qui fait une bonne ou une mauvaise adaptation cinématographique d’une pièce de théâtre. La problématique examinée ici est celle de la traduction.
Il est important de différencier entre adaptation et traduction, car cette dichotomie aide à contraster deux modes de transposition cinématographique bien distincts. Comme on l’a vu, le concept d’adaptation s’apparente à la paraphrase et décrit un procédé de ré-écriture qui s’applique toujours à l’interprétation cinématographique de la narration littéraire. Parler d’adaptation d’un roman ou d’une pièce de théâtre suggère que le film s’inspire de l’intrigue, du thème ou des personnages d’un texte original. En ce sens, une adaptation ne peut pas vraiment être évaluée en terme de fidélité, car cette pratique implique toujours une transformation fondamentale du matériau de départ. Bien que l’on puisse parler d’adaptation de pièce de théâtre, on ne peut pas parler de traduction cinématographique du roman. Le principe de traduction cinématographique ne s’applique qu’aux cas - relativement rares d’ailleurs – où un cinéaste tente de trouver des équivalents filmographiques pour les codes théâtraux. Il s’agit d’un choix volontaire de la part du cinéaste qui travaille en vue d’atteindre le plus haut degré d’adéquation possible entre le langage cinématographique et le langage théâtral. L’intention du réalisateur qui traduit une pièce de théâtre est donc différente de celle du cinéaste qui s’inspire d’une pièce de théâtre, d’un roman ou d’un fait divers. La question de la fidélité, par exemple, est très importante pour le traducteur et sans intérêt véritable pour l’adaptateur. C’est pourquoi ce serait une erreur de reprocher à John Greyson d’avoir produit une traduction médiocre de l’oeuvre de Bouchard, car le cinéaste n’avait nullement l’intention de traduire la pièce. Malgré que Lilies soit un meilleur film que Gapi, l’oeuvre de Blouin demeure un bien meilleur exemple de traduction de la scène à l’écran, même si le film aurait pu être plus agréable à visionner si le cinéaste avait choisi d’être moins fidèle et de nous montrer les «fesses de la belle Immaculata».
NOTES
1 Notre traduction.
Return to article
2 Voir entre autres la description du décor dans Louise Vigeant, «Les
Muses orphelines», Jeu 49 (1988): 197-199.
Return to article
3 Presque tout le cinéma populaire présente l’espace de façon réaliste.
Même les films de science-fiction situent leurs personnages dans un
environnement concret qui évite l’abstraction et les artifices symboliques.
Voir les commentaires d’André Bazin sur l’artificialité du locus
dramaticus théâtral et le réalisme de l’environnement cinématographique
dans Qu’est-ce que le cinéma? (Paris: Éditions du
Cerf, 1975): 158-161.
Return to article
4 Voici un exemple plus évident: prenons ce passage qu’on retrouve à la première page de la version originale de Crime et châtiment (1865) de Dostoïevski:
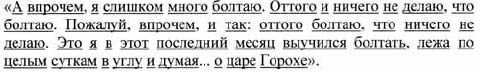
Ce texte n’a aucun effet sur moi; il ne signifie absolument rien; il n’a
pas de sens.Cependant, le même passage dans l’adaptation de Crime
et châtiment que Lev Kulijanov a réalisée en 1970 peut m’émouvoir
même si je n’en comprends pas les mots, car je peux apprécier la
composition austère de l’image et ressentir l’émotion dans l’élocution
troublée du narrateur qui parle une langue que je ne connais pas,
mais d’une voix dont les intonations et le timbre ont un sens sinon
une signification.
Return to article
5 Charles Eidsvik, Cineliteracy: Film among the Arts (New York:
Random House, 1978): 233.
Return to article
6 Cet effet de narration est très différent de l’effet de monstration de la
pièce de Tremblay, À toi, pour toujours, ta Marie-Lou, par exemple,
dans laquelle les événements des années l961 et 1971 sont montrés au
présent. L’action de 1961 n’est pas narrée à l’imparfait.
Return to article
7 N’est-ce pas pourquoi les émissions d’information télévisées
montrent toujours un visage humain qui communique les nouvelles?
Si le visage disparaît, l’intérêt du spectateur disparaît aussi.
Return to article
8 Voir à ce sujet Bazin 160.
Return to article
9 Voir, entre autres, l’article de L.Klady «Gapi» (Variety 1, 1982: 19),
dans lequel l’auteur déplore son aspect trop «stage-bound,» trop
ancré au théâtre.
Return to article
OUVRAGES CITÉS
Alter, Jean. A Sociosemiotic Theory of the Theatre.Philadelphia:University of Pennsylvania Press, 1990.
Bazin,André.Qu’est-ce que le cinéma? Paris: Éditions du Cerf, 1975. Belzil, Patricia. «Contraintes et libertés de la scénarisation: Entretien avec Michel Marc Bouchard.» Jeu 88 (1998): 46-67.
Bluestone, George. Novels into Film. Berkeley: University of California Press, 1957.
Bouchard,Michel Marc. Les Muses orphelines.Montréal: Leméac, 1989. Chiasson, Zénon. «Gapi et Sullivan, drame d’Antonine Maillet.» Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec: Tome V 1970–1975. Montréal: Fides, 1984.
Eidsvik, Charles. Cineliteracy: Film among the Arts. New York: Random House, 1978.
Fisher-Lichte, Erika. The Semiotics of Theatre. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1992
Gaudreault, André. Du littéraire au filmique: système du récit. Québec: Presses de l’Université Laval, 1988.
Gémar, Jean-Claude. Traduire ou l’art d’interpréter. Québec: Presses de l’Université du Québec, 1995.
Griffith, James. Adaptations as Imitations.Newark:University of Delaware Press; London:Associated University Press, 1997.
Groensteen, Thierry. «Le processus adaptatif (tentative de récapitulation raisonnée).» La Transécriture. André Gaudreault et Thierry Groensteen (dir.).Québec: Éditions Nota bene, 1998. 273-275.
Larose, Robert. Théories contemporaines de la traduction, 2e éd. Québec: Presses de l’Université du Québec, 1989.
Loiselle, André. «Les Muses orphelines du théâtre au cinéma: en conversation avec Robert Favreau.» L’Annuaire théâtral 30 (2001): 97-106.
Maillet,Antonine. Gapi.Montréal: Leméac, 1976. Pavis, Patrice. Dictionnaire du théâtre. Paris: Dunod, 1996.
Rice-Baker, Leo. «Special report: The Genie Awards: Lilies extends men’s emotional range.» Playback (4 novembre 1996): 43.
Ropars-Wuilleumier, Marie-Claire. De la littérature au cinéma. Paris: Armand Colin, 1970.
Stam, Robert. «Beyond Fidelity: The Dialogics of Adaptation.» Film Adaptation. James Naremore (dir.). New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2000.
Tremblay, Michel. Les belles-soeurs. Montréal: Holt, Rinehart et Winston, 1968.